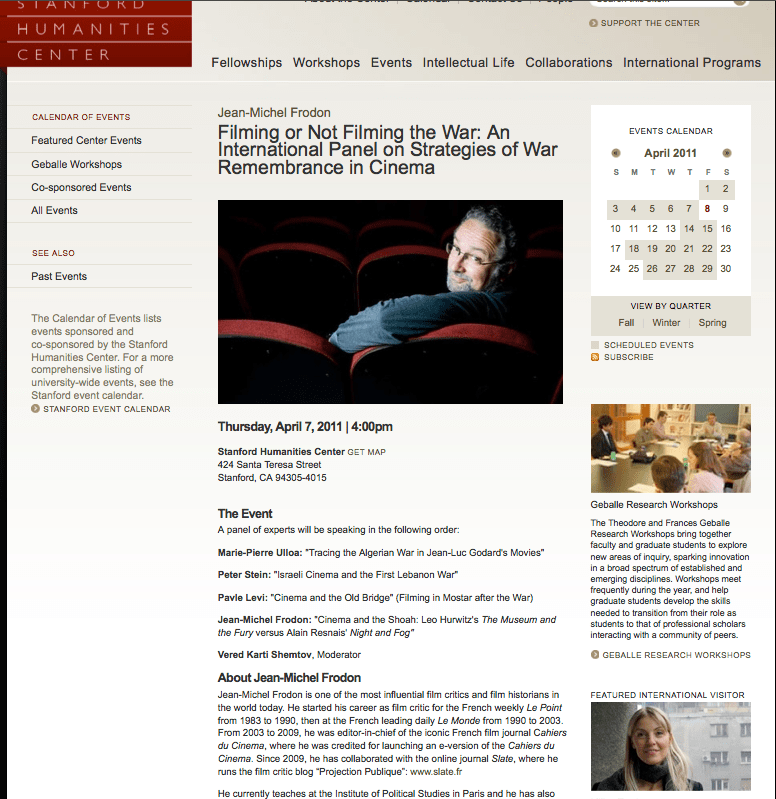Eau argentée de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxaet. 1h43. Sortie le 17 décembre.
Eau argentée de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxaet. 1h43. Sortie le 17 décembre.
En mai 2011, alors que les affrontements embrasaient son pays, la Syrie, Ossama Mohammed quittait Damas. Il venait à Cannes présenter un court métrage, L’Adolescent et la botte, et témoigner de la terreur exercée par la soldatesque de Bachar el-Assad contre son peuple alors désarmé, et qui réclamait un terme à des décennies d’oppression totale.
Ossama Mohammed n’est jamais retourné en Syrie. Depuis Paris, il a entrepris un travail de cinéaste à partir d’éléments qu’il avait apportés avec lui, d’enregistrements postés sur YouTube, puis d’une correspondance –textes et vidéos– avec une jeune réalisatrice de Homs assiégée. Elle se prénomme Simav, ce qui en kurde signifie «eau argentée». La deuxième partie du film est surtout composée de plans tournés par Simav et des échanges par chat entre Ossama et elle.
Eau argentée jaillit des images le plus souvent tournées à la DV ou avec un téléphone portable, des mots des habitants de Derra et de Homs, de ceux de conversations du réalisateur avec des personnes rencontrées sur place, et aussi de sa voix off depuis Paris où il distille également, caméra en main, un léger contre-point à la déferlante venue de là-bas.
Déferlante de terreur, de sang et de douleur. Déferlante inédite, quand bien même on a vu beaucoup de ces images, ou d’autres comparables. Ce n’est pas tant l’effet d’accumulation, au lieu du fractionnement des posts YouTube, ou des «sujets» télé qui fait la différence, c’est la construction d’une écoute, d’une attention, d’une intelligence qui sans cesse déploie le sens de ce qui est ici montré.
Puisqu’au milieu de tout cela, il y a, au-delà de l’empathie poignante, «du» sens. Certainement pas «un» sens, mais des stratégies, des choix, de la part de toutes les personnes impliquées. Parmi ces personnes se trouvent aussi celles qui sont dans le camp du pouvoir et qui, sur ordre ou par gloriole personnelle, filment et mettent en ligne les atrocités qu’elles commettent.
Il apparaît qu’il existe bien un choix stratégique des dirigeants de faire filmer au téléphone portable (comme ceux d’en face) les séances de torture dans les commissariats et de les diffuser. Les séides de Bachar El-Assad utilisent eux aussi les réseaux sociaux pour répandre la terreur, y compris en rendant perceptible la jouissance du flic de base d’enregistrer les coups et les humiliations qu’infligent ses collègues, jusqu’à cette séquence où le troufion met en scène son officier: «Allez-y lieutenant, cognez-le sur la tête, avec le pied c’est mieux, l’autre à côté aussi», dit la voix off qui tient l’iPhone tandis qu’on voit la rangers qui shoote dans un visage, ajoutant sur le mur blanc une longue trace de sang supplémentaire.
Des multiples intelligences que recèle Eau argentée, la compréhension in situ des puissances contradictoire des images n’est pas la moindre. (…)
LIRE LA SUITE