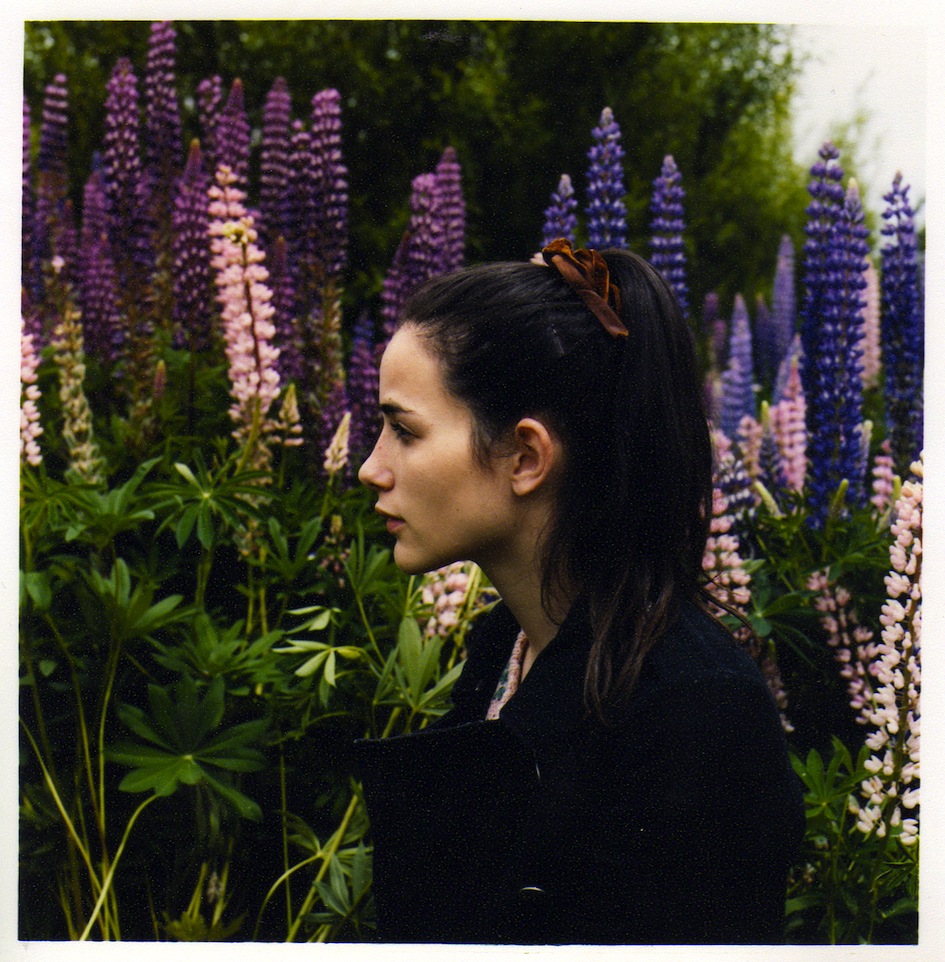A Cappella de Lee Sujin, avec Chun Woo-hee, Lee Youg-lan. 1h52. Sortie le 19 novembre.
A Cappella de Lee Sujin, avec Chun Woo-hee, Lee Youg-lan. 1h52. Sortie le 19 novembre.
Il est assez rare de nos jours de rencontrer un film sans en rien savoir. Entre systèmes de repérage (genre, thème, vedettes, nom du réalisateur…) et prolifération de discours d’accompagnement (publicité, critique, buzz…), la quasi-totalité des films arrivent accompagnés d’un cortège d’indices plus ou moins fiables. Or, voici que ce premier film d’un réalisateur coréen surgit parmi les 20 (20 !) nouvelles sorties de ce mercredi 19 novembre sans aucun éléments d’identification a priori.
Surtout, pour autant que des esprits assez aventureux prendraient le risque d’aller à sa rencontre, A Cappella ne fera rien pour clarifier les choses, ne présentera pas ses papiers, entretiendra durant près d’une heure une féconde incertitude sur les raisons d’agir de ses protagonistes, et la tonalité d’ensemble de l’œuvre.
Loin d’être un obstacle, cette incertitude se révèle au contraire une richesse, porteuse d’intensité, de curiosité, de capacité à s’intéresser à de multiples registres, de la comédie adolescente au drame de société, de la chronique quotidienne à l’interrogation sur les notions de vérité, de culpabilité et de puissance.
Finalement le récit livrera davantage d’éléments d’explication et inscrira le film dans ce qui est bien une sorte de genre, particulièrement nourri en Asie, le film de collège sous le signe de la cruauté des rapports entre adolescents et du renoncement des adultes, genre dont relevait récemment La Frappe de Yoon Sung-yun, également venu de Corée mais situé cette fois cette fois côté garçons.
Cadré par cette thématique, le film n’y perd rien en émotion et en complexité, grâce à un sens de la narration non linéaire et de la mise en scène privilégiant la présence charnelle et l’inscription des corps dans des ambiances toujours très sensorielles. Déplacée, manipulée, à la fois volontaire et toujours prête à l’esquive, la jeune Gong-ju, interprétée avec intensité et complexité par Chun Woo-hee (révélée par l’admirable Mother de Bong Joon-ho) existe au-delà du fait divers sinistre qui marque son destin. De même les figures qui l’entourent (le prof qui l’emmène dans une autre école, la mère de celui-ci chez qui elle loge, la nouvelle copine de lycée, le garçon victime de harcèlements violents, la mère de Gon-ju, son père, etc.), sont toujours à la fois dessinés avec précision et habités de dimensions qui dépassent l’anecdote ou la seule nécessité dramatique.
Lee Sujin possède ce talent peu commun de savoir donner une présence, un potentiel affectif et narratif, à quiconque apparaît devant sa caméra. Assurément A Cappella raconte à la fois l’histoire d’une jeune fille et un état pas franchement exaltant de la société coréenne. Surtout, il réussit à engendrer un monde à la fois cohérent et complexe, un monde d’émotions, d’énergies et de rapports de force que la mise en scène rend perceptible de multiples manières, au service, si on veut, de ce qu’il raconte, mais jamais asservi par un sujet ou un thème, vibrant de multiples harmoniques qui l’excède et ne le rende que plus réel, et plus émouvant. Un monde où le sexe, la musique, la famille, l’éducation, la natation, nourrissent autant de branches qui se renforcent réciproquement.
Ainsi, ayant fini par expliciter son thème central et la clé dramaturgique qui organise la succession de situations, A Cappella dépasse son propre sujet, s’épanouit selon plusieurs lignes de force à la fois, devient universel tout en restant physiquement ancré dans sa réalité. Et c’est fort bien ainsi.