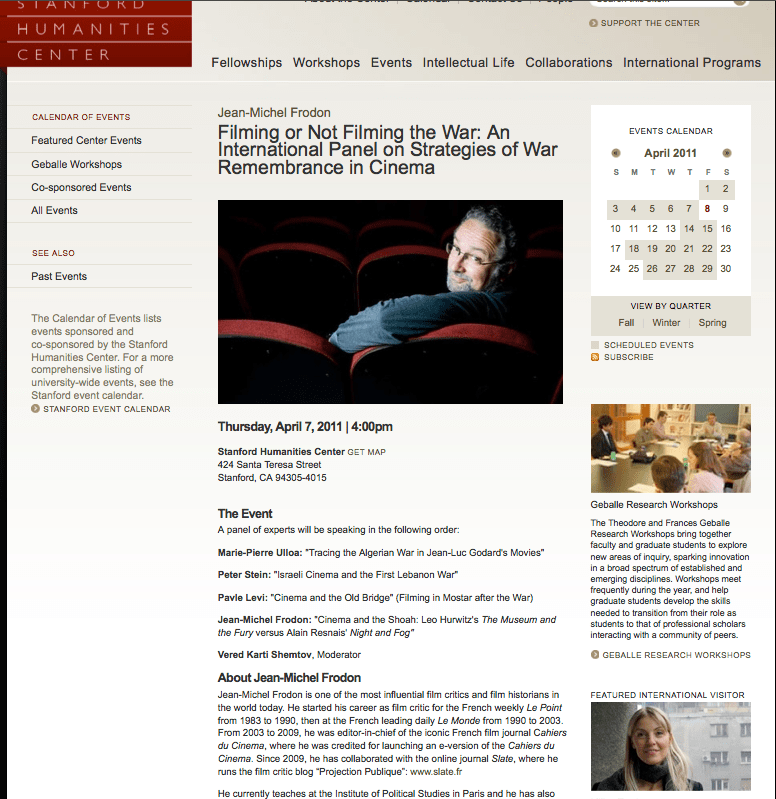Avoir 20 ans dans les Aurès de René Vautier
Treize nouveaux films sortent en salles ce mercredi 3 octobre. Pas tous vus – j’en rattraperai certains dans les jours qui viennent – et dans l’inhabituelle absence de désir d’écrire sur aucun de ceux déjà vus. Ni le gentil Indé US du jour (Elle s’appelle Ruby), ni le vilain et racoleur énième pseudo-renouveau de la comédie italienne (Reality), ni l’improbable numéro d’Attal et Cluzet, pas antipathique mais terriblement vain (Do Not Disturb) – sans parler de l’imbécillité et de la vulgarité de Pauline détective… Beaucoup plus stimulante est la revoyure, à 40 ans de distance, d’Avoir 20 ans dans les Aurès. Impossible de prétendre découvrir le film de René Vautier, vu sa sortie, quand les futurs fondateurs du Front national menaçaient de faire sauter les salles qui le projetaient – et à l’occasion le faisaient. Plutôt dans la curiosité, amplement satisfaite, de ce que fait la vision aujourd’hui de ce film si inscrit dans son temps. Réponse : il fait du bien, et il fait gamberger. En ces temps où on n’en finit pas de payer le prix de l’impuissance de la République française à prendre en charge la vérité de son histoire, y compris de ses crimes (la lamentable pantalonnade autour de l’expo Camus à Aix en ayant été la plus récente illustration), le premier long métrage non immédiatement interdit de Vautier vibre d’un désir de dire, de montrer, de faire sentir et comprendre, qui n’a rien perdu de son allant.
René Vautier, cinéaste français, communiste breton, résistant antinazi et militant anticolonialiste, avait tourné son premier film consacré l’Algérie, Une nation l’Algérie, avant le début de l’insurrection de novembre 1954. Il avait ensuite rejoint les rangs des combattants algériens, aux côtés desquels il réalisait en 1957 Algérie en flammes, puis, dans les maquis et après la victoire, aidait à la formation des réalisateurs du pays ayant recouvré son indépendance. Autant dire que le bonhomme connaît les lieux, les hommes et les situations. Son film n’est pourtant pas vraiment « sur » la guerre d’Algérie, même s’il s’appuie sur des centaines d’heures de témoignages d’appelés pour composer cette fiction. Entièrement situé du côté d’un commando de chasse de l’armée française, il met en évidence nombre d’aspects alors passés sous silence, et frappés d’interdit et de censure, à commencer par la violence exercée sur les populations civiles, y compris « gratuitement », hors du cadre de la torture systématique pour rechercher des renseignements.
Mais ce qui intéresse le plus Vautier est de (donner à) comprendre les mécanismes qui mènent une bande de gars plutôt sympathiques, plutôt rebelles, à commettre des actes abjects et à servir une machine politico-militaire pour laquelle ils n’avaient aucune inclination. Situé en 1961, au moment du putsch des généraux dont on suivra à la radio les principales péripéties, Avoir 20 ans dans les Aurès se passe entièrement en extérieurs, dans des paysages lunaires de caillasses, de montagnes et de sables qui évoquent aussi l’Arizona ou le Nouveau Mexique des westerns. Plus qu’un récit à proprement parler, le réalisateur y met en place une série de situations. Ce sont les deux caractéristiques les plus saillantes du film : l’importance des paysages, de la dureté des lumières, de la violence de l’environnement naturel au sein duquel prend place celle des hommes, et le caractère semi-improvisé des scènes interprétés par une troupe de jeunes acteurs (dont Jean-Michel Ribes) sous les ordres d’un lieutenant Philippe Léotard de 30 ans qui en paraît 20.
Le télescopage de l’expérimentation marquée par le théâtre de Brecht, y compris l’emploi de songs en guise de chœur pas du tout antique, et du documentaire de roche et de soleil donne au film une puissance qui traverse les décennies. La vitalité parfois maladroite des interprètes et la présence intense des lieux se réverbèrent et s’amplifient au fil de séquences chacune porteuse d’un « message », mais qui ne s’y laisse jamais enfermer. L’énergie à la fois rageuse et très incarnée du film, y compris sa tendresse secrète pour le personnage pourtant négatif de Léotard, apparaît intacte, ou peut-être même accrue par la distance dans le temps – un temps qui a été celui d’une étrange « reconnaissance » des faits sans qu’en ait été tirée aucune leçon, sans qu’aient été construites, ni avec les Algériens, ni avec les anciens appelés ni avec les Pieds Noirs, les conditions d’un vivre ensemble après « ça ».
Cette énergie est encore plus impressionnante si on la compare avec la perte quasi-irrémédiable qui semble émaner du nouveau film de Michel Khleifi, Zindeeq, autre nouveauté de cette semaine. Le film raconte le retour à sa Nazareth natale d’un réalisateur palestinien hanté de fantômes politiques et sentimentaux et traqué par des ombres. Cette fois les ressorts du théâtre de l’absurde et de la distanciation paraissent terriblement usés, égocentriques, sans prise sur le réel – et d’autant plus qu’au même moment paraissent (enfin !) en DVD les deux grands films du même Khleifi, Noces en Galilée (1987) et Le Cantique des pierres (1990), aux édition des Films du Paradoxe. Comme le film de Vautier, ces films-là rayonnaient de la sensation d’avoir été fait « avec » – avec leurs interprètes, avec l’histoire, avec des copains et complices, avec colère, espoir et lucidité, quand la nouvelle réalisation du réalisateur palestinien établi en Europe exsude une solitude malsaine, qu’il essaie sans doute de conjurer en la décrivant, mais où finalement il s’abime.