
Journal d’une demi-Berlinale n°4

Il est absolument incompréhensible que la présentation de Pina, Dance, dance, otherwise we are lost, le nouveau film de Wim Wenders à la Berlinale le 13 février dernier n’ait pas été salué comme un événement majeur, et l’incontestable sommet de ce Festival. D’abord parce qu’il s’agit d’un film magnifique et bouleversant, le plus beau réalisé par Wim Wenders depuis très longtemps. Ensuite parce qu’il s’agit d’une œuvre pionnière, qui ouvre une nouvelle voie pour le cinéma de manière plus décisive qu’aucune autre réalisation 3D à ce jour. Enfin parce qu’on pourrait se souvenir, en Allemagne un peu mieux qu’ailleurs, que l’auteur de Paris Texas et des Ailes du désir a été durant une décennie tenu non sans raison comme le meilleur cinéaste de sa génération, et que si son succès même l’a conduit dans des chemins décevants et solitaires, c’est une manière d’événement de le voir renouer avec un tel niveau d’excellence, non pas en retournant sur ses pas (il ne l’a jamais fait, c’est tout à son honneur, même quand cela s’est traduit en errances, et en errements) mais en s’aventurant sur des chemins nouveaux, que seuls un grand artiste de cinéma, un grand connaisseur amoureux du cinéma était capable d’explorer.
Mais il faut revenir d’abord au film lui-même. Revenir à sa beauté fulgurante, qui s’invente aux confins des splendeurs chorégraphiques conçues par Pina Bausch, de l’émotion suscitée par sa disparition, et de la manière de filmer, en scène et en extérieur, en action et en paroles, ce qui a été construit par le Tanztheater Wuppertal. Revenir à l’émotion dans l’évocation de la personnalité de la chorégraphe par celles et ceux qui l’ont accompagnée dans sa quête, émotion que Wenders rend d’autant mieux perceptible qu’il la ressent lui-même. Cette affection du cinéaste pour celle à qui il dédie ce film en même temps qu’il le lui consacre est pour beaucoup dans l’ovation qui a salué le film à l’Urania, l’immense salle berlinoise où il était possible aujourd’hui de le « rattraper ». Pour comprendre le bonheur qu’offre Pina, il faut revenir à cette source inépuisable de beauté et de force cinématographique à laquelle il puise généreusement : filmer le travail. Filmer les corps et la pensée au travail, la sensibilité et l’inspiration transmuées patiemment en gestes, en actes, en pratiques : dans cet exercice-là, le cinéma est irremplaçable.




Employer la 3D pour un tel projet semble de prime abord absurde, ou vain. Il faut à Wim Wenders une intelligence égale de la danse telle que la concevait Pina Bausch et du cinéma pour au contraire en faire l’occasion d’une double magnification, d’une double évidence. Evidence retrouvée de la poésie, de l’humour et de l’énergie qui président à cette succession vertigineuse de créations collectives, évidence d’un rapport nouveau mais pourtant qui se justifie en permanence de l’image cinématographique à l’espace tridimensionnel. En regardant le film, on s’aperçoit que la 3D permet ce qui au cinéma aurait été presqu’impossible autrement : construire physiquement la constante articulation de l’individuel et du collectif qui se joue en permanence dans les ballets de Pina Bausch, dans son travail avec ses danseurs. Et aussi : donner toute leur présence aux corps des danseurs et plus encore des danseuses, aux volumes des seins, des fesses et des cuisses, et à l’érotisme puissant qui s’impose dès la représentation du Sacre du printemps, au début du film, en même temps que sont admirablement rendus les drapés et les textures, mais aussi la puissance des masses de corps, féminins ici, masculins là, qui s’aimantent et qui s’affrontent.
Mais Wenders n’en reste pas là. Il ne se contente pas de filmer l’espace scénique, il y pénètre. Et s’y déplace, avec ceux qui en sont en principe les seuls occupants. Il ose des mouvements de caméra 3D qu’on aurait crus impossibles sans des déséquilibres et des pertes de repères, mais que sa sensibilité de cinéaste (admirablement soutenue par le travail du spécialiste de cette technologie, Alain Derobe) transforme en véritables harmoniques visuelles du spectacle dansé. Et encore : il sort les danseurs dans les rues de Wuppertal, les emmène dans l’étonnant métro suspendu pour un scène gag mémorable avec monstre et oreiller, ou de vertigineux travellings embarqués. Il les envoie à la piscine, les installe dans une cimenterie ou au milieu d’un carrefour. Et voilà cette danse des pulsions intimes inscrite dans le monde, jouant des proximités et des lointains (« si loin si proche », bien sûr), des souvenirs et du présent, de la stylisation extrême et d’un réalisme prêt à en découdre avec les matières, avec les lumières, avec les morphologies, avec les bruits et les choses du monde.
Ce n’est pas, pas du tout comme assister à un spectacle de Pina Bausch, c’est par de toutes autres voies retrouver leur vérité profonde, leur justesse. Et c’est, en tournant un documentaire où la mise en scène est revendiquée à chaque plan, montrer combien la 3D peut tenir toute sa place dans la construction de représentations du réel, aussi loin des impératifs du spectacle forain de l’heroic fantasy ou du dessin animé que d’un pseudo-naturalisme du relief. C’est affirmer que toute image de cinéma, documentaire ou de fiction – c’est ici de manière si évidente les deux à la fois – est une construction, un geste de cinéaste, et que bien sûr la 3D peut y prendre sa place, et devenir partie prenante du vocabulaire d’un artiste.
On s’en fiche de faire un concours de créativité entre Cameron et Wenders, à ce jour il existe deux grands films en 3D, Avatar et Pina. L’un comme l’autre sont riches de promesses immenses, on a vu à ce qui a suivi Avatar combien ces promesses étaient difficiles à tenir, celles dont le film de Wenders est porteur le sont tout autant, il n’en est que plus remarquable, et plus chargé de désir de voir ce qui viendra ensuite.




 Janos Derzsi et Erika Bok dans Le Cheval de Turin de Béla Tarr
Janos Derzsi et Erika Bok dans Le Cheval de Turin de Béla Tarr






 Le jeune homme décide de passer à son tour à la réalisation, avec ce projet singulier dont le résultat sera présenté à Cannes 1954 par deux prestigieux parrains, Luis Buñuel et Jean Cocteau. Le projet de Marc’O est de construire une transcription cinématographique de ce qui pourrait se former comme images mentales chez un personnage imaginaire, dont nous ne saurons rien d’autre que ces représentations. Nous saurons en revanche selon quel principe est conçu le film, un préambule en explicitant les idées, et les procédures de réalisation. Avant le surgissement par association libre de scènes oniriques, érotiques, grotesques ou angoissantes, cette mise à distance critique, ou même pédagogique, est l’un des aspects qui distingue Closed Vision du cinéma d’art des années 20 et 30, sous l’influence des surréalistes. Le film de Marc’0 apparaît ainsi comme une sorte de chainon manquant entre d’une part Le Chien andalou et Le Sang d’un poète, œuvres de ses parrains cannois, mais aussi A propos de Nice de Jean Vigo ou La Coquille et le clergyman de Germaine Dulac, et d’autre part ce que feront, selon des approches différentes, Jean-Luc Godard, Alain Resnais et Chris Marker : l’interrogation des processus mentaux de représentation par le cinéma selon des approches à la fois poétiques et critiques. Déjà à l’époque, l’essai cosigné par Resnais et Marker, Les Statues meurent aussi, exact contemporain de Closed Vision, lui fait en partie écho.
Le jeune homme décide de passer à son tour à la réalisation, avec ce projet singulier dont le résultat sera présenté à Cannes 1954 par deux prestigieux parrains, Luis Buñuel et Jean Cocteau. Le projet de Marc’O est de construire une transcription cinématographique de ce qui pourrait se former comme images mentales chez un personnage imaginaire, dont nous ne saurons rien d’autre que ces représentations. Nous saurons en revanche selon quel principe est conçu le film, un préambule en explicitant les idées, et les procédures de réalisation. Avant le surgissement par association libre de scènes oniriques, érotiques, grotesques ou angoissantes, cette mise à distance critique, ou même pédagogique, est l’un des aspects qui distingue Closed Vision du cinéma d’art des années 20 et 30, sous l’influence des surréalistes. Le film de Marc’0 apparaît ainsi comme une sorte de chainon manquant entre d’une part Le Chien andalou et Le Sang d’un poète, œuvres de ses parrains cannois, mais aussi A propos de Nice de Jean Vigo ou La Coquille et le clergyman de Germaine Dulac, et d’autre part ce que feront, selon des approches différentes, Jean-Luc Godard, Alain Resnais et Chris Marker : l’interrogation des processus mentaux de représentation par le cinéma selon des approches à la fois poétiques et critiques. Déjà à l’époque, l’essai cosigné par Resnais et Marker, Les Statues meurent aussi, exact contemporain de Closed Vision, lui fait en partie écho.






 Une image de Shoah de Claude Lanzmann
Une image de Shoah de Claude Lanzmann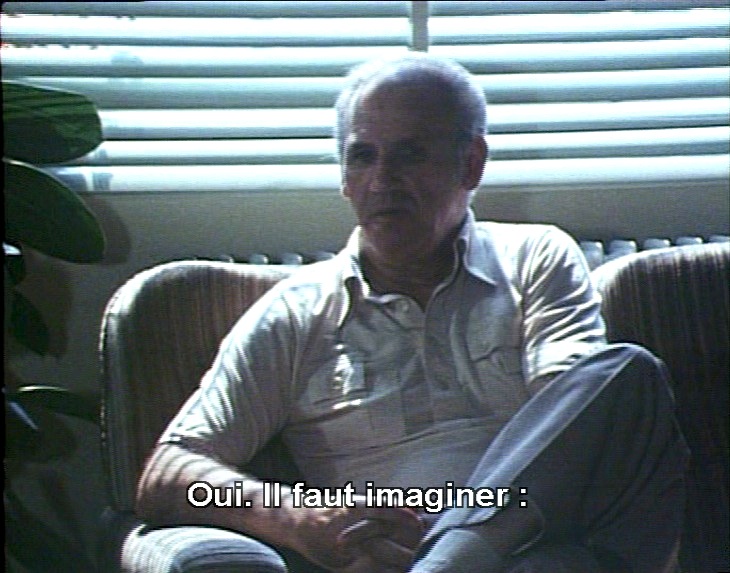 Filip Müller dans Shoah
Filip Müller dans Shoah Inglourious Basterds de Quentin Tarantino
Inglourious Basterds de Quentin Tarantino
 Dans La Jeune Fille de l’eau de M. Night Shyamalan, le mauvais critique finissait dévoré par les monstres de la fiction auxquels il ne croyait pas.
Dans La Jeune Fille de l’eau de M. Night Shyamalan, le mauvais critique finissait dévoré par les monstres de la fiction auxquels il ne croyait pas.

 Je reçois souvent des invitations à participer à des festivals, fréquemment comme membre d’un jury. J’y réponds de mon mieux, tant je suis convaincu de l’importance de ces manifestations, notamment des « petits festivals » qui irriguent, en France particulièrement, un riche tissu de relations entre spectateurs et films. Mais souvent je dois refuser, pour des problèmes d’emploi du temps. Lorsque j’ai reçu l’invitation à présider le jury du Festival
Je reçois souvent des invitations à participer à des festivals, fréquemment comme membre d’un jury. J’y réponds de mon mieux, tant je suis convaincu de l’importance de ces manifestations, notamment des « petits festivals » qui irriguent, en France particulièrement, un riche tissu de relations entre spectateurs et films. Mais souvent je dois refuser, pour des problèmes d’emploi du temps. Lorsque j’ai reçu l’invitation à présider le jury du Festival 
 La soirée du palmarès achèvera de consacrer cette évidence, celle du talent d’une jeune cinéaste comme de la richesse possible de l’interaction entre enjeux cinématographiques et scientifiques : avant notre propre récompense, le prix du public et le prix du Jury jeune ira… à La Pieuvre de Laetitia Carton.
La soirée du palmarès achèvera de consacrer cette évidence, celle du talent d’une jeune cinéaste comme de la richesse possible de l’interaction entre enjeux cinématographiques et scientifiques : avant notre propre récompense, le prix du public et le prix du Jury jeune ira… à La Pieuvre de Laetitia Carton.

 Raed Andoni (à gauche) chez le psy
Raed Andoni (à gauche) chez le psy