
Depuis longtemps, chaque fois que j’ai l’occasion de parler de l’œuvre de Don DeLillo, je dis qu’il n’est pas seulement, selon moi, le plus grand écrivain américain vivant, mais aussi un des plus grands cinéastes américains contemporains. Et ce bien qu’à ma connaissance il n’ait jamais rien réalisé.
L’affinité de DeLillo avec le cinéma est évidente, dès son premier roman, Americana (1973), dont le personnage principal se lance dans un projet de film radical. Et un de ses plus grands romans, Les Noms (1982), comporte ce qui est sans doute le meilleur portrait littéraire d’un cinéaste – partiellement inspiré de Martin Scorsese – jamais composé. Mais il s’agit de bien autre chose que de références cinématographiques ou de personnages faisant des films. Et cela n’a rien à voir non plus sur la possibilité de transposer ses textes à l’écran : l’appétissante perspective d’une adaptation de Cosmopolis par David Cronenberg, annoncée pour l’an prochain, n’est en rien significative à cet égard – il faut avoir confiance en Cronenberg pour se réapproprier tout à fait l’ouvrage.
 Don DeLillo à l’époque de L’Homme qui tombe
Don DeLillo à l’époque de L’Homme qui tombe
C’est autre chose que ces voisinages superficiels. C’est l’écriture de Don DeLillo qui construit un rapport aux êtres et aux choses, à l’espace et au temps, qui relève d’une interaction du réalisme et de la fiction qui est cela même dont le cinéma est capable. Et qui ne se trouve pas chez les autres écrivains. Par exemple, bien que n’existant que sous forme imprimée, Libra (1988) est aussi le meilleur travail cinématographique sur l’assassinat de Kennedy qui soit, quand le film JFK d’Oliver Stone est un exercice (assez pauvre) de composition mélangeant journalisme et discours militant.
On a repéré, à raison, une sorte de pressentiment d’événements futurs dans les livres de DeLillo : c’est le pouvoir même que recèle le cinéma de voir le monde dans ses potentialités, potentialités que la mise en scène (pour le dire mieux que le mot « fiction », qui induit en erreur) rend sensible. Outremonde (1997) « annonce » le 11 septembre comme Deux ou trois choses que je sais d’elle de Jean-Luc Godard annonçait Mai 68, comme Fight Club (1999) de David Fincher a lui aussi « annoncé » la destruction des tours. Parce qu’elle tresse de multiples agencements de causes et d’effets, on a dit l’œuvre de DeLillo « conspirationniste » alors qu’elle est seulement une prise en compte de la complexité du réel, une mise en forme par l’écriture des enchevêtrements de forces qui y agissent, selon un processus infiniment plus « réaliste », et donc plus en phase avec la réalité politique, que les soi-disant grands romans politiques américains comme Pastorale américaine et Complot contre l’Amérique de Philip Roth ou Underworld USA de James Ellroy, qui sont de gentilles bluettes politiques, mais de grands romans moraux – tout autre chose.
Les livres de DeLillo sont politiques, et cinématographiques, parce qu’ils ne se nourrissent que de ce qu’il appelle les « effets », les traces dans le réel, les manifestations perceptibles des forces qui agissent le monde. C’est ce qu’il résume lorsqu’il dit « Prenez Libra : je n’ai eu l’idée d’écrire sur Lee Harvey Oswald que vingt ans après les faits, en découvrant qu’il avait habité dans le Bronx près de l’endroit où j’avais vécu aussi. A l’époque, il avait 13 ans et j’en avais 16. J’ai réalisé que je pouvais peut-être me faire une idée de cet homme car pendant une année j’avais vu les mêmes choses que lui, j’avais vécu dans le même environnement. Voilà pourquoi Libra commence dans le Bronx. Cela m’a surpris d’écrire sur l’assassinat de Kennedy, je ne l’ai jamais planifié. C’était un défi enrichissant de m’impliquer dans l’histoire à ce point, parce que cet événement a eu un effet sur la conscience du monde. Dans le cas du 11 Septembre, j’étais déterminé à ne pas décrire l’attentat en train de se produire derrière l’épaule d’un personnage. Je voulais écrire sur ses effets. Pour l’Irak, c’est un peu pareil. » Ce passage se trouve dans la meilleure interview en français de l’écrivain que j’ai pu lire, accessible sur le site des Inrocks.
 J’avoue volontiers que ce sentiment très fort éprouvé à la lecture des livres de DeLillo est difficile à démontrer, tout simplement parce que « ce qu’est le cinéma » est pratiquement impossible à formuler autrement que par des approximations autour d’un ressenti : un certain rapport au monde. Et voici que le nouveau livre de DeLillo s’en vient comme rédiger la notice de cette idée même. Point Omega, dont la (remarquable) traduction par Marie-Catherine Vacher vient d’être publiée chez Actes Sud, est le petit livre noir de cette alchimie. Il s’ouvre par un texte impressionnant, qui élève au cube, si j’ose dire, la relation au cinéma. DeLillo y écrit en effet ce qui se joue dans un film classique, Psychose d’Hitchcock, film une première fois réinterrogé dans son processus physique même par l’installation de Douglas Gordon 24 Hour Psycho, qui dilate sur 24 heures une projection du film, et à son tour analysé (au sens chimique comme au sens psy) par le travail du romancier sur cette expérience.
J’avoue volontiers que ce sentiment très fort éprouvé à la lecture des livres de DeLillo est difficile à démontrer, tout simplement parce que « ce qu’est le cinéma » est pratiquement impossible à formuler autrement que par des approximations autour d’un ressenti : un certain rapport au monde. Et voici que le nouveau livre de DeLillo s’en vient comme rédiger la notice de cette idée même. Point Omega, dont la (remarquable) traduction par Marie-Catherine Vacher vient d’être publiée chez Actes Sud, est le petit livre noir de cette alchimie. Il s’ouvre par un texte impressionnant, qui élève au cube, si j’ose dire, la relation au cinéma. DeLillo y écrit en effet ce qui se joue dans un film classique, Psychose d’Hitchcock, film une première fois réinterrogé dans son processus physique même par l’installation de Douglas Gordon 24 Hour Psycho, qui dilate sur 24 heures une projection du film, et à son tour analysé (au sens chimique comme au sens psy) par le travail du romancier sur cette expérience.
Les critiques littéraires américains (deux adjectifs qui présupposent une aversion évidente envers pareille entreprise) ont logiquement détesté le livre, même si la reconnaissance dont jouit DeLillo les empêche de le dire ouvertement, on ne sait jamais. Nombreux sont ceux qui, faute d’attaques plus frontales, ont écrit que c’était sûrement très bien tout ça, mais plus proche de l’essai théorique que du roman. Contresens total. C’est précisément comme artiste lui-même, comme artiste de l’écriture, que Don DeLillo parvient à formuler quelque chose de décisif sur la nature du cinéma, ou plutôt sur ce qu’est un rapport cinématographique à la réalité, aux êtres humains, au récit, etc. – rapport dont nous savons désormais qu’il peut être mis en œuvre avec d’autres outils que ceux du cinéma au sens technique (par exemple en littérature, mais aussi dans les arts plastiques), tandis que nombreux sont hélas les films entièrement dépourvus de cinéma.
Passé ce prologue consacré à 24 Hour Psycho, le livre met en œuvre dans l’ordre du récit littéraire ce qu’il a décrit à partir de l’installation de Douglas Gordon. Il le fait en « ralentissant » à son tour à l’extrême le processus dramatique, c’est-à-dire le face-à-face entre un vieil intellectuel qui a participé à la planification de la guerre en Irak et un jeune documentariste. La fille du vieil homme les rejoint dans leur refuge au milieu du désert, Mojave ou Sonora, une hypothèse de relation amoureuse avec le cinéaste, la possibilité d’un crime, l’énigme d’une disparition font partie des classiques « rebondissements », mais les événements rebondissent comme ralentis à l’extrême. Un livre de « suspens », mais qui prend acte du glissement du sens de ce mot tel qui s’est produit, disons, entre Hitchcock et Antonioni. Dans ce décor de western, dans la torpeur californienne (ou est-ce l’Arizona ?), les durées, les rythmes, les gestes, les idées se désarticulent, se désaffectent. En rupture avec un univers du contrôle, de l’apparence, de l’accélération et de la manipulation dont la guerre en Irak serait une sorte d’hyper-symptôme sinistre et spectaculaire, le processus de récit applique une mise en crise douce, et d’autant plus radicale et profonde qu’elle est soft.


Anthony Perkins dans Psychose d’Alfred Hitchcock, David Hemmings dans Blow-up de Michelangelo Antonionio
L’enjeu n’est pas, n’est jamais intérieur à une réflexion seulement sur l’art, ou sur les seuls processus esthétiques de représentation. DeLillo le dit très clairement à propos de ce que Gordon avait fait du film de Hitchcock : « Ce film avait la même relation avec l’original que l’original avec l’expérience vécue réelle ». Ce que j’ai appelé la réflexion au cube sur le cinéma à propos de 24 Hour Psycho est en fait une réflexion sur la réalité à la puissance 4. La différence est que dans le corps du récit « l’original » (qui serait un roman classique mettant aux prises ses trois protagonistes sur fond d’échec de la guerre en Irak) n’est pas ici exposé. Point Omega est en ce sens plus audacieux que 24 Hour Psycho, puisqu’il met en jeu l’état subliminal, travaillé de l’intérieur par le geste artistique, en escamotant le matériau intermédiaire, ces représentations « au premier degré » qui ignorent, et donc dissimulent, qu’il y a toujours du dispositif, un metteur en scène, de la représentation spectaculaire. Qui évacue qu’il n’y a qu’un monde, « la réalité », et que les images, les œuvres, les signes en font partie, et que tout ce qui prétend le nier est machine de leurre et d’oppression.
C’est ce que met en œuvre l’épilogue du livre, en activant non sans humour la fusion de son cadre et de son « contenu » (le prologue et le corps du récit), par un retour dans la chambre noire au cœur du Musée d’art moderne de New York où un personnage anonyme passe ses journées avec l’œuvre de Douglas Gordon. Ce point de convergence, cette revendication d’un seul monde avec lequel il faut apprendre à avoir affaire en suspendant les effets de sens trop explicites et les illusions d’optique de l’idéologie et de la marchandise, c’est le sens même de l’expression « Point Omega », empruntée à Teilhard de Chardin en opérant un glissement de sens qui en respecte l’esprit tout en le dénudant de tout aspect religieux.
Tout ça avec un petit livre de 140 pages, qui se lit comme on traverse un songe, qui ne donne que l’envie d’y revenir.





 Le tournage de Fifth Night
Le tournage de Fifth Night


 Une image de Shoah de Claude Lanzmann
Une image de Shoah de Claude Lanzmann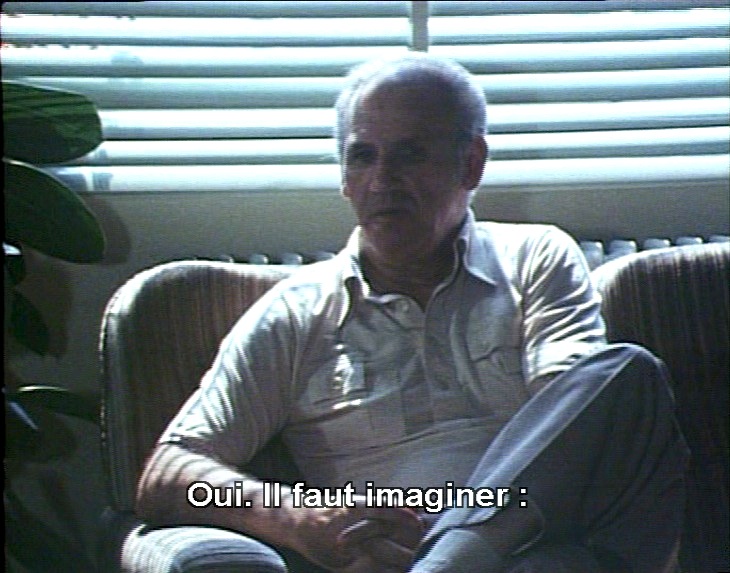 Filip Müller dans Shoah
Filip Müller dans Shoah Inglourious Basterds de Quentin Tarantino
Inglourious Basterds de Quentin Tarantino
 Dans La Jeune Fille de l’eau de M. Night Shyamalan, le mauvais critique finissait dévoré par les monstres de la fiction auxquels il ne croyait pas.
Dans La Jeune Fille de l’eau de M. Night Shyamalan, le mauvais critique finissait dévoré par les monstres de la fiction auxquels il ne croyait pas.

 Je reçois souvent des invitations à participer à des festivals, fréquemment comme membre d’un jury. J’y réponds de mon mieux, tant je suis convaincu de l’importance de ces manifestations, notamment des « petits festivals » qui irriguent, en France particulièrement, un riche tissu de relations entre spectateurs et films. Mais souvent je dois refuser, pour des problèmes d’emploi du temps. Lorsque j’ai reçu l’invitation à présider le jury du Festival
Je reçois souvent des invitations à participer à des festivals, fréquemment comme membre d’un jury. J’y réponds de mon mieux, tant je suis convaincu de l’importance de ces manifestations, notamment des « petits festivals » qui irriguent, en France particulièrement, un riche tissu de relations entre spectateurs et films. Mais souvent je dois refuser, pour des problèmes d’emploi du temps. Lorsque j’ai reçu l’invitation à présider le jury du Festival 
 La soirée du palmarès achèvera de consacrer cette évidence, celle du talent d’une jeune cinéaste comme de la richesse possible de l’interaction entre enjeux cinématographiques et scientifiques : avant notre propre récompense, le prix du public et le prix du Jury jeune ira… à La Pieuvre de Laetitia Carton.
La soirée du palmarès achèvera de consacrer cette évidence, celle du talent d’une jeune cinéaste comme de la richesse possible de l’interaction entre enjeux cinématographiques et scientifiques : avant notre propre récompense, le prix du public et le prix du Jury jeune ira… à La Pieuvre de Laetitia Carton.




 Omar Ben Sellem dans Homme au bain de Christophe Honoré
Omar Ben Sellem dans Homme au bain de Christophe Honoré




 Don DeLillo à l’époque de L’Homme qui tombe
Don DeLillo à l’époque de L’Homme qui tombe J’avoue volontiers que ce sentiment très fort éprouvé à la lecture des livres de DeLillo est difficile à démontrer, tout simplement parce que « ce qu’est le cinéma » est pratiquement impossible à formuler autrement que par des approximations autour d’un ressenti : un certain rapport au monde. Et voici que le nouveau livre de DeLillo s’en vient comme rédiger la notice de cette idée même. Point Omega, dont la (remarquable) traduction par Marie-Catherine Vacher vient d’être publiée chez Actes Sud, est le petit livre noir de cette alchimie. Il s’ouvre par un texte impressionnant, qui élève au cube, si j’ose dire, la relation au cinéma. DeLillo y écrit en effet ce qui se joue dans un film classique, Psychose d’Hitchcock, film une première fois réinterrogé dans son processus physique même par l’installation de Douglas Gordon 24 Hour Psycho, qui dilate sur 24 heures une projection du film, et à son tour analysé (au sens chimique comme au sens psy) par le travail du romancier sur cette expérience.
J’avoue volontiers que ce sentiment très fort éprouvé à la lecture des livres de DeLillo est difficile à démontrer, tout simplement parce que « ce qu’est le cinéma » est pratiquement impossible à formuler autrement que par des approximations autour d’un ressenti : un certain rapport au monde. Et voici que le nouveau livre de DeLillo s’en vient comme rédiger la notice de cette idée même. Point Omega, dont la (remarquable) traduction par Marie-Catherine Vacher vient d’être publiée chez Actes Sud, est le petit livre noir de cette alchimie. Il s’ouvre par un texte impressionnant, qui élève au cube, si j’ose dire, la relation au cinéma. DeLillo y écrit en effet ce qui se joue dans un film classique, Psychose d’Hitchcock, film une première fois réinterrogé dans son processus physique même par l’installation de Douglas Gordon 24 Hour Psycho, qui dilate sur 24 heures une projection du film, et à son tour analysé (au sens chimique comme au sens psy) par le travail du romancier sur cette expérience.
