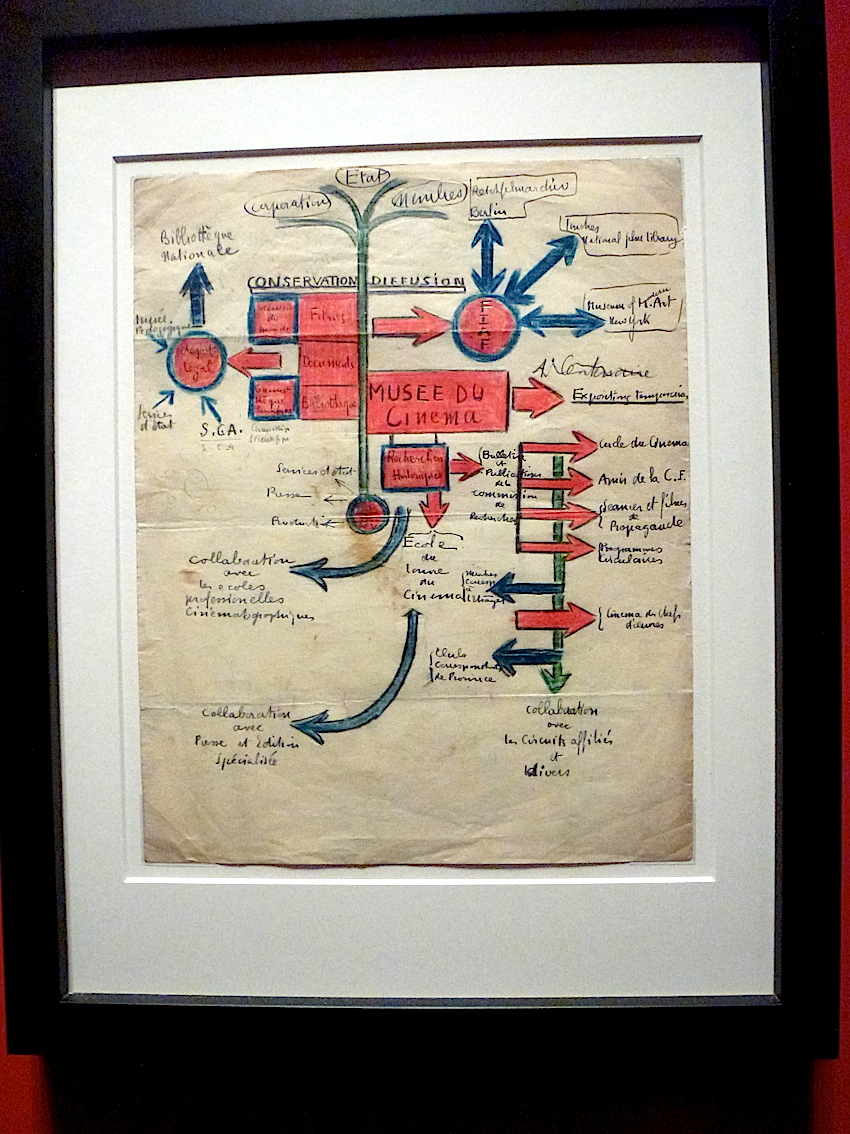Ours d’or à Berlin, Dahomey est né d’un choc, celui que Matti Diop a ressenti à l’évocation par Emmanuel Macron de la restitution par la France de vingt-six œuvres à la République du Bénin. À l’occasion de sa sortie en France (après le Bénin et le Sénégal), la réalisatrice et productrice revient sur les enjeux post-coloniaux de cette restitution, les étapes de création de son film, son rapport à la fiction comme au documentaire, et la portée politique de son travail, « contre-récit » de l’Histoire africaine.
Ours d’or au dernier Festival de Berlin, le film de Mati Diop est remarquable à plus d’un titre. Dahomey accompagne non seulement un événement riche de sens, la première restitution importante d’objets d’arts pillés par les forces coloniales françaises, mais de multiples aspects des réflexions suscitées par ces problématiques, les relations entre la France et ses anciennes colonies, les conditions d’exposition des objets concernés, dans un grand musée parisien et en Afrique. Pour ce faire, Dahomey invente une forme singulière, où interagissent documentaire, fantastique et débat réflexif sur les processus en cours. Par ses enjeux tout autant que par son écriture cinématographique originale, le film s’inscrit dans le parcours extrêmement riche d’un questionnement poétique et politique des questions décoloniales menée par la réalisatrice par les moyens du cinéma, dont le court-métrage Atlantiques (2009), le moyen métrage Mille Soleils (2013) et le long-métrage de fiction Atlantique (2019, Grand Prix du Festival de Cannes) ont marqué des étapes. Si la restitution au Bénin des « vingt-six trésors d’Abomey » que conservait le Musée du Quai Branly est, entre autres, une suite directe donnée au considérable travail synthétisé par le rapport Sarr-Savoy de 2018, la cinéaste, par ses choix de mise en scène, en poursuit pour partie, en reconfigure à d’autres titres, les réflexions et les avancées, dans le registre artistique qui lui est propre. Poème et essai autant que document, Dahomey est aussi, ou d’abord, un film vibrant d’émotion, d’admiration pour ce qui circule entre des humains et des œuvres, un film de trouble devant les échos infinis entre visible et invisible, présent et passé, imaginaire et réalité. J.-M.F.
Pouvez-vous décrire le processus qui a mené à la naissance d’un film aussi singulier que Dahomey?
Pendant le confinement, j’ai beaucoup réfléchi à la dimension politique que j’avais envie de donner à mes films et ce à quoi j’avais envie de consacrer mes prochaines années. Mes films précédents étaient déjà politiques, oui, mais la question était comment faire davantage corps avec le réel et surtout avec le présent. Pour la première fois, je me suis posée plus frontalement la question du documentaire. Jusque-là, je cultivais une ambiguïté entre fiction et documentaire, qui pouvait prendre plusieurs formes mais sans appeler de choix entre les deux. Mais face à la situation sociale et politique que nous traversions, j’ai traversé une sorte de « crise » de la fiction : je ne me voyais pas consacrer des mois et des mois à composer une histoire, cela me semblait déphasé par rapport à ce que je percevais comme une accélération de l’histoire, une intensification des événements. Je ne voulais pas que les exigences de la fiction m’éloignent d’un réel envers lequel j’avais un sentiment d’urgence. Ainsi a commencé un processus qui a mené à Dahomey, où je n’ai finalement pas du tout renoncé à la fiction, mais qui m’a donné le sentiment de faire corps avec des événements en train de se produire et de participer à l’écriture d’un moment historique. C’est aussi le cas d’un autre film auquel j’ai commencé à travailler au même moment, toujours en cours et consacré à Rachel Keke et à sa campagne pour les législatives 2022. Ces films sont nés de la nécessité de ne pas choisir entre conception et action.
Donc, l’idée de Dahomey nait à ce moment-là ?
Ah non, je pensais à ce qui allait devenir Dahomey depuis 2017 et le discours de Ouagadougou où Emmanuel Macron annonce la possibilité du retour d’objets africains sur le continent. A ce moment, je terminais l’écriture du scénario d’Atlantique, lorsque le mot, et l’idée de restitution sont revenus sur le devant de la scène. Le mot « restitution » m’a comme… giflée.
C’est-à-dire ?
Pour deux raisons. D’abord, je me suis rendue compte, avec stupeur, que la présence extrêmement massive d’objets volés par les puissances coloniales, exposés et stockés dans les musées européens est un angle des réalités postcoloniales que j’avais négligée. J’ai senti qu’en cela, j’étais moi aussi victime d’une tentative française d’effacement. C’est très violent, pour une personne afro-descendante, de s’apercevoir qu’on a été sujette au projet colonial de dissimuler l’histoire et que ce projet avait en l’occurrence fonctionné avec moi puisque mon imaginaire, qui restait donc en grande partie à décoloniser, n’avait pas suffisamment pris conscience de l’ampleur de la chose, c’est-à-dire de la présence de plus d’un demi millions d’œuvres africaines incarcérées dans les musées européens. L’ingéniosité de la mise en scène muséale avait réussi à créer une sorte de brouillard qui normalisait, pour moi, ce qui n’aurait jamais dû m’apparaitre comme normal. Je parle des sorties scolaires au musée de l’Homme ou au Quai Branly où je ressentais un fort malaise sans être réellement confrontée aux faits. On n’explique pas vraiment aux enfants la violence du contexte. Du coup on crée des pathologies. Mensonge, déni. La deuxième raison est que ce terme, restitution, que je n’avais pas entendu jusqu’alors, venait donner un nom à ce qui caractérise ma démarche de cinéaste depuis le court-métrage Atlantiques en 2008. Lorsque je choisis de filmer Serigne qui raconte sa traversée en mer de Dakar depuis l’Espagne, le geste est de lui rendre une parole dont les médias de masse occidentaux le dépossèdent en niant son humanité, son individualité et sa subjectivité. Raconter lui-même son histoire et l’expérience de la traversée avec ses mots replace Serigne au centre de sa propre histoire. « Restituer » comporte l’idée qu’on a enlevé quelque chose, qu’on a volé à l’autre et qu’on rend.
C’est-à-dire que lorsqu’entre dans le débat public la notion de restitution, vous avez le sentiment qu’elle s’applique à l’ensemble de votre travail, et en particulier à Atlantiques, Mille Soleils et Atlantique.
Surtout les deux films « Atlantique(s) », oui. C’est l’idée du contre-récit, d’une réappropriation de son histoire, de la création d’un nouvel imaginaire. Décoloniser le regard sur les réalités africaines. Le cinéma a ce pouvoir et, en ce qui me concerne, ce devoir, de restituer.
Vous avez évoqué la mise en scène muséographique et ses effets, y compris sur vous. Comment la percevez-vous, vous dont le travail est aussi de mettre en scène ?
On sait bien aujourd’hui que toute muséographie est un discours, un récit. Et on sait qu’un récit est toujours la marginalisation ou l’effacement d’autres récits. C’est, dans une certaine mesure, vrai en toutes circonstances, mais de manière particulièrement active, violente et devant être interrogé dans un endroit comme ce qui a été le Musée de l’Homme, aujourd’hui le Musée du Quai Branly. Toute la scénographie, la disposition, les lumières, le choix des informations fournies ou pas, les manières de rapprocher certaines pièces, travaillent à rendre invisibles les conditions de spoliation brutale dans lesquelles ces œuvres ont été acquises, et le contexte dans lequel cela s’est produit. Bénédicte Savoy en parle si bien[1]. La muséographie de Branly, c’est la mise en scène de l’idéologie de l’universalisme. Aujourd’hui, nous savons cela, mais cela opère toujours !
Donc le mot « restitution » est au point de départ de votre envie de film, de ce film-là ?
Oui, également sous le signe du retour. Pour moi, il faisait écho aux revenants d’Atlantique, le long-métrage. J’ai eu le sentiment que le retour des œuvres en pays natal avait quelque chose en commun avec ce mouvement. Mais à ce moment-là, je pensais encore réaliser un film de fiction, et même de science-fiction. Je voulais raconter l’étrange épopée d’un masque africain, depuis sa fabrication jusqu’à sa restitution qui devait se passer en 2070 en passant par son pillage puis tout son parcours en Europe. Ce n’est pas parce que Macron avait ouvert l’hypothèse de restitutions à Ouagadougou que je croyais assister à cela dans les années suivantes – nous avons appris à ne pas apporter grand crédit à la parole de l’actuel président. Quand il est apparu que vingt-six trésors royaux allaient effectivement être rendus au Bénin, j’ai instantanément déclenché les possibilités d’un tournage. Mais à ce moment, j’étais toujours dans une logique de fiction, disons afro-futuriste, où ces images que je voulais tourner de la restitution auraient pu avoir le statut d’archives du passé dans un récit situé dans plusieurs décennies.
Est-ce en tournant les scènes documentaires qui ouvrent le film, celles de la mise en caisse des trésors à Branly, que vous avez compris qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire ce moment dans une fiction ?
Oui. Je n’ai jamais renoncé à la fiction, au fantastique, mais les équilibres se sont déplacés. Les conditions dans lesquelles nous avons tourné étaient très riches, visuellement et émotionnellement, il n’y avait à ce moment-là aucun besoin d’ajouter des éléments romanesques. Ces conditions de tournage généraient du cinéma, du mystère, du danger, peut-être plus et mieux que ce qu’organise plus artificiellement un scénario de fiction. En documentaire, il n’y a qu’un seul endroit possible pour la caméra, et on n’a droit qu’à une seule prise. Pour moi, le dispositif filmique consistait à raconter ce départ du Quai Branly puis ce retour du point de vue des œuvres.
Aviez-vous suivi de près la publication du rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy[2] ?
Il m’a beaucoup intrigué à sa sortie en 2018, mais j’étais alors en pleine promo d’Atlantique un peu partout dans le monde, j’étais moins disponible. Ensuite, quand le nouveau projet s’est précisé, je l’ai lu bien sûr. C’est un ouvrage hyper éclairant. Je n’ai pour autant jamais cherché à devenir une experte sur le sujet. Je tenais à conserver un rapport intime et émotionnel avec ce que cette restitution provoquait en moi. Je voulais que Dahomey garde la trace du trouble que j’ai éprouvé face à tout ce que soulève ce mot. Mon film vient d’un endroit très sensoriel, d’un séisme intérieur.
Concrètement, comment avez-vous fait pour vous faufiler à l’intérieur de ce processus lourd et compliqué, avec des implications politiques et diplomatiques, logistiques, de communication, etc.?
J’ai très vite compris que sans un accord actif du Bénin, le film était impossible. Pour une cinéaste indépendante, c’est une situation délicate de devoir obtenir la collaboration et le soutien d’un gouvernement. Il s’est trouvé que le conseiller du ministre de la Culture béninois, José Plya, connaissait très bien mon travail et l’appréciait, cela a bien aidé. Avec mes coproductrices, Judith Lou Levy et Eve Robin des Films du Bal, nous avons obtenu leur aide tout en imposant une totale indépendance.
Le tournage au Musée du Quai de Branly permet de faire la connaissance d’un personnage qui a un grand rôle dans cette histoire, Calixte Biah.
Calixte est historien et conservateur du musée d’Histoire de Ouidah au Bénin. Je l’ai rencontré en plein tournage de la séquence du Quai Branly. Quand je l’ai découvert en action, j’ai immédiatement compris qu’il était celui sous l’autorité de qui toute cette opération de retour avait lieu. Il y avait chez lui une gravité, un soin et une attention envers les œuvres qui, à mes yeux, allaient bien au-delà d’une dimension professionnelle. Il entretenait une conversation secrète avec les œuvres. Tout en restant une personne réelle d’une grande capacité scientifique et technique, il est pour moi instantanément devenu un des personnages, au sens romanesque et presque légendaire, du film. Je l’ai perçu comme le Gardien des œuvres, à cheval entre deux mondes. Il faut dire qu’on était toutes et tous un peu dépassé(e)s par la dimension historique, et à certains égards mythique, du moment.
Cette dimension mythologique renvoie à ce parti pris très fort dans le film de faire entendre une voix, qui est possiblement la voix de Ghézo, le grand roi du Dahomey au milieu du 19e siècle, dont la statue est le trésor numéro 26, et possiblement une voix plus collective…
Cette voix est un élément essentiel du film. Elle n’était pas présente au début. Dès que j’ai commencé à tourner, j’ai su que je voulais que ce retour soit perçu depuis le point de vue des œuvres, qu’elles redeviennent le centre de leur histoire, des sujets et non plus des objets. Mais longtemps, j’ai considéré que le plus fort serait un silence complet, en tout cas une absence de mots, au moins jusqu’à l’arrivée au Bénin. Qu’elles conservent, ou retrouvent leur opacité, au sens si important que donne Edouard Glissant à ce mot. Puis, j’ai éprouvé le besoin de les faire parler à la première personne, d’abord en empruntant des fragments de L’Énigme du retour de Danny Laferrière[3], qui raconte comment il ramène à Haïti le corps de son père mort à New York. Je voulais que cette voix appartienne à plusieurs contextes. Laferrière n’a pas souhaité que j’emprunte des fragments de son texte alors j’ai confié l’écriture de la voix des trésors au poète et romancier haïtien Makenzy Orcel, écriture à laquelle j’ai aussi collaboré.
Dans leur rapport, Sarr et Savoy parlent à propos des œuvres africaines d’ « objets créoles », en fait devenus créoles du fait de leur long séjour dans un autre contexte que celui où ils ont été créés[4].
C’est si juste. Et c’est ce que nous continuons de tisser dans le film, en particulier avec l’apport de ces voix mêlées qui parlent la langue du Dahomey, la langue fon. En mêlant plusieurs locuteurs à partir du texte conçu par un auteur haïtien, c’est en augmenter la caisse de résonance créole, tout en redonnant une place centrale à l’africanité. (…)