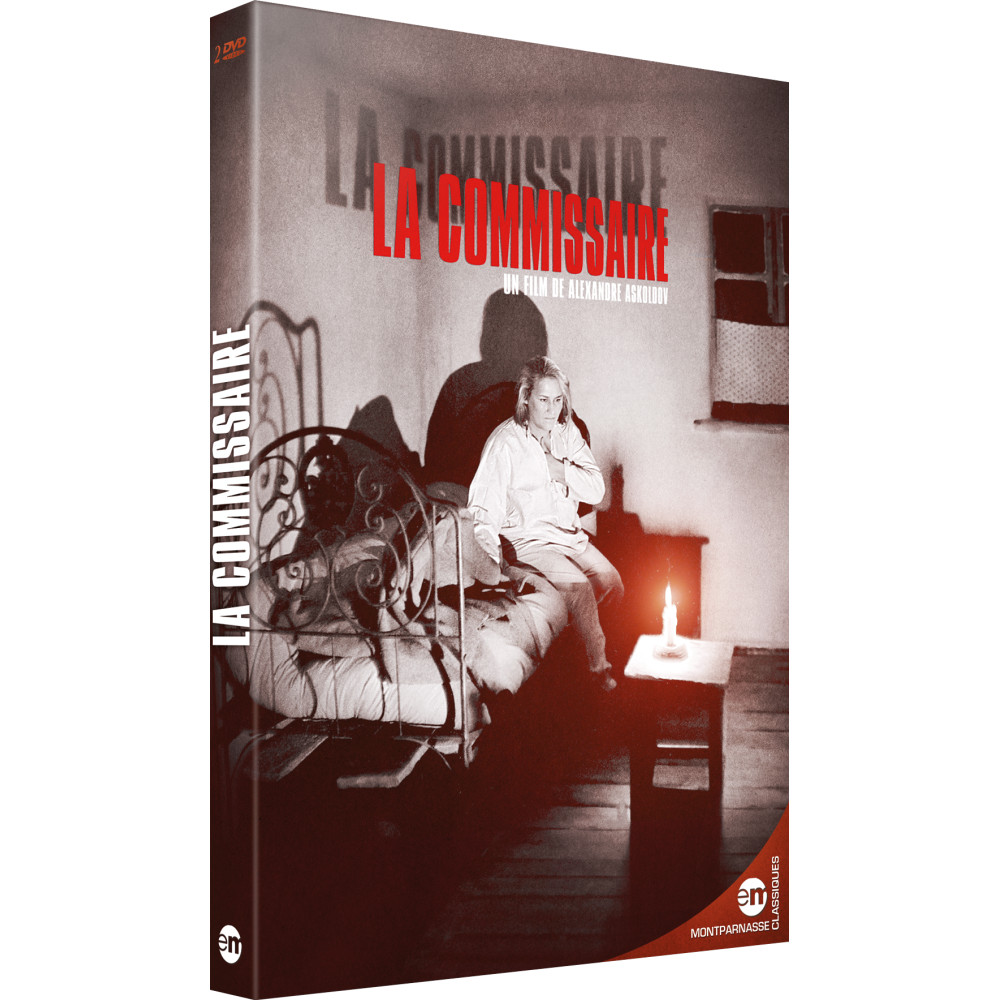Survol du cinéma mondial tel qu’il s’est présenté dans les salles de cinéma françaises durant 2013.
Adèle Exarchopoulos dans La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche
Sur les écrans, l’offre très riche de films dignes d’intérêt traduit aussi une certaine confusion, et des manques criants. Le critère de description le plus pertinent demeure sans aucun doute l’origine géographique : malgré les effets réels de la mondialisation, les films dans leur immense majorité demeurent inscrits dans des contextes nationaux très identifiables, aussi bien par les histoires qu’ils racontent, par les procédés de mise en scène qu’ils utilisent que, bien sûr, par les interprètes qui les incarnent.
Les Etats-Unis avaient commencé l’année en force avec le passionnant Thirty Dark Zero de Kathryn Bigelow, l’impressionnant Django de Quentin Tarantino, ou le film le plus ambitieux de Steven Spielberg depuis longtemps, Lincoln. Cette année où le box-office mondial aura été entièrement dominé par des sequels (Iron Man 3, Moi moche et méchant 2, Fast and Furious 6, Bilbo 2… ) est très rentable pour les studios, et pratiquement sans intérêt en terme de proposition de cinéma de la part des Majors, à l’exception de l’intrigant World War Z, et en reconnaissant que Hunger Games 2 a gardé l’élan du premier.
 Inside Llewyn Davis des frères Coen
Inside Llewyn Davis des frères Coen
De grands auteurs étatsuniens se sont malgré tout distingués, à commencer par l’admirable Inside Llewyn Davis des frères Coen, mais aussi le très réussi Ma vie avec Liberace de Steven Soderberg, The Immigrant de James Gray, un très bon Woody Allen, Blue Jasmine, Mud qui confirme le talent de Jeff Nichols, et le convaincant All is Lost de JC Chandor – tandis que la poudre aux yeux de Gravity connaissait un succès démesuré. On concèdera à Martin Scorsese de s’être répété sans se trahir avec Le Loup de Wall Street.
 Il faut faire une place à part à Leviathan de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, production états-unienne (du Sensory Ethnography Lab de Harvard) mais parfait OVNI cinématographique, sans doute la proposition la plus singulière et la plus suggestive qu’on ait vu sur grand écran depuis fort longtemps.
Il faut faire une place à part à Leviathan de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel, production états-unienne (du Sensory Ethnography Lab de Harvard) mais parfait OVNI cinématographique, sans doute la proposition la plus singulière et la plus suggestive qu’on ait vu sur grand écran depuis fort longtemps.
 Haewon et les hommes de Hong Sang-soo
Haewon et les hommes de Hong Sang-soo
Parmi les régions du monde les plus fécondes, il faut faire bonne place à la Corée, à l’Amérique latine et au Moyen-Orient. De Corée, on a ainsi vu arriver deux réussites du prolixe Hong Sang-soo, Haewon et les hommes et Our Sunhi, le beau Pink de Jeon Soo-il ou, dans un genre très différent, le dynamique Snowpiercer de Bong Joon-ho. Sans qu’un pays s’impose particulièrement, la galaxie latino-américaine aura présenté nombre d’œuvres de belle qualité, comme No du Chilien Pablo Larrain, d’Argentine Elefante blanco de Pablo Trapero et Leones de Jazmin Lopes, La Sirga du Colombien William Vega et La Playa D.C. de son compatriote Juan Andres Arango, les Mexicains Post Tenebras Lux de Carlos Reygadas, La Jaula de oro de Diego Quemada-Diez et Workers de Jose Luis Valle…
 Dans un jardin je suis entré d’Avi Mograbi
Dans un jardin je suis entré d’Avi Mograbi
Quant au Moyen-Orient, il aura surtout attiré attention grâce à des réalisations palestiniennes (Omar de Hany Abu-Assad, Cinq caméras brisées de Emad Burnat et Guy Davidi, A World Not Ours de Mahdi Fiefel) et israéliennes (Dans un jardin je suis entré d’Avi Mograbi, Lullaby to my Father d’Amos Gitai Le Cours étrange des choses de Rafael Nadjari, Invisible de Michal Aviad, Not in Tel-Aviv de Nony Geffen). Mais il faut aussi faire place à sa passionnante proposition des Libanais Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, The Lebanese Rocket Society, sans oublier la surprise saoudienne Wadjda de Haifa Al-Mansour –alors que le pays le plus fécond d’ordinaire dans la région, l’Iran, aura brillé par son absence dans les salles françaises, effet combiné de la glaciation de l’ère Ahmadinejad, d’une frilosité des distributeurs et d’un retard pour quelques œuvres importantes découvertes en festival, notamment celles des deux plus célèbres proscrits, Jafar Panahi et Mohamad Rassouloff.
 A Touch of Sin de Jia Zhang-ke
A Touch of Sin de Jia Zhang-ke
Dans les salles, l’Asie (hors Corée) a été insuffisamment représentée, même si c’est de Chine qu’est venu peut-être le plus grand film de l’année, A Touch of Sin de Jia Zhang-ke, tandis que Hong Kong sauvait la face grâce au très élégant Grandmaster de Wong Kar-wai et à l’émouvant Une vie simple d’Ann Hui. Deux valeurs sures, Kiyoshi Kurosawa (Shokuzai) et Hirokazu Kore-eda (Tel père tel fils) ont conservé au Japon une place honorable. On se souviendra aussi du débutant chinois Cai Shang-jun (People Mountain People Sea) et de son collège thaïlandais Anocha Suwichakompong (Mundane History), en attendant les films importants de Tsai Ming-liang et Wang Bing, sans oublier le Philippin Raya Martin.
Quant à l’Afrique et au Maghreb, ils font toujours figures de parents très pauvres, malgré le magnifique Aujourd’hui d’Alain Gomis et Grigris de Mahmat Saleh Haroun.
 Isabelle Huppert dans La Belle Endormie de Marco Bellocchio
Isabelle Huppert dans La Belle Endormie de Marco Bellocchio
Dans une Europe plutôt terne, on aura vu se confirmer un lent réveil de l’Italie, représentée aussi bien par des grands cinéastes chevronnés (Moi et toi de Bernardo Bertolucci, La Belle Endormie de Marco Bellocchio) que par les premiers longs métrages L’Intervallo de Leonardo Di Costanzo , Salvo de Fabio Grassadonia et Antonio Plazza, sans oublier Miele de Valeria Golino ou Amore carne de Pippo Delbono. Deux très beaux films Histoire de ma mort du Catalan Albert Serra et Dans la brume de l’Ukrainien Sergei Loznitsa semblent comme surgis du néant, tout comme le remarquable Vic+Flo ont vu un ours du Québécois Denis Côté, auquel on devait aussi le poétique essai documentaire Bestiaire.
Juliette Binoche dans Camille Claudel 1915 de Bruno Dumont et, ci-dessous, Pierre Deladonchamps et Christophe Paou dans L’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie.
Reste, bien sûr, le cas français. C’est à dire, comme on se doit de le souligner chaque année, le pays qui reste globalement le plus fécond en propositions de cinéma, même s’il inonde aussi ses écrans – et autant qu’il peut ceux des autres – de navets innombrables et navrants. A tout seigneur tout honneur, il faut saluer d’abord La Vie d’Adèle, d’Abdellatif Kechiche, magnifique réussite d’un très grand cinéaste, consacrée d’une palme d’or, succès en salle en France et à l’étranger, Prix Louis Delluc, œuvre importante et qui le restera quand seront retombées les écumes nauséabondes nées dans son sillage. Mais dans quel autre pays trouve-t-on la même année des œuvres aussi fortes et aussi singulières que La Jalousie de Philippe Garrel, Le Dernier des injustes de Claude Lanzmann, Jimmy P. d’Arnaud Desplechin, Les Salauds de Claire Denis, Jaurès de Vincent Dieutre, Bambi de Sébastien Lifschitz, et encore ces deux véritables coups de tonnerre cinématographiques, Camille Claudel de Bruno Dumont et L’Inconnu du lac d’Alain Guiraudie ? A noter aussi combien plusieurs de ces films – ceux de Kechiche et de Guiraudie, mais aussi de Dieutre et de Lifchitz – résonnent avec les débats qui on agité la société française cette année.
Le jeune cinéma français aura fait en 2013 l’objet d’enthousiasmes parfois disproportionnés. Mais il aura en effet donné naissance à des découvertes réellement prometteuses, qui s’intitulent Fifi hurle de joie de Mitra Farahani, Ma Belle Gosse de Shalimar Preuss, Les Lendemains de Bénédicte Pagnot, Casa Nostra de Nathan Nicholovitch ou encore Deux automnes trois hivers de Sébastien Betbeder.
Quelle est la valeur de cette géographie subjective de l’année de cinéma vue des écrans français ? Elle est à l’évidence conjoncturelle. Mais globalement, elle dessine avec exactitude les zones de force et de faiblesse caractéristiques du cinéma mondial de la période actuelle telle qu’il nous est donné de la percevoir. Avec de réels effets de distorsion, comme l’absence récurrente, chez nous, de la pourtant toujours très dynamique cinématographie indienne, dont le gentillet Lunchbox ne donne qu’une traduction édulcorée, complaisante aux goûts européens, ou la disproportion entre la montée en puissance du cinéma chinois, désormais le deuxième du monde, et l’écho qu’on en perçoit ici. Et pourtant témoin assez fidèle d’un dynamisme à la fois impressionnant et très inégalement réparti du cinéma mondial.